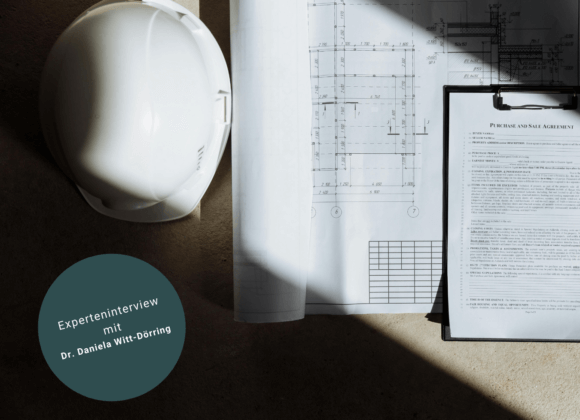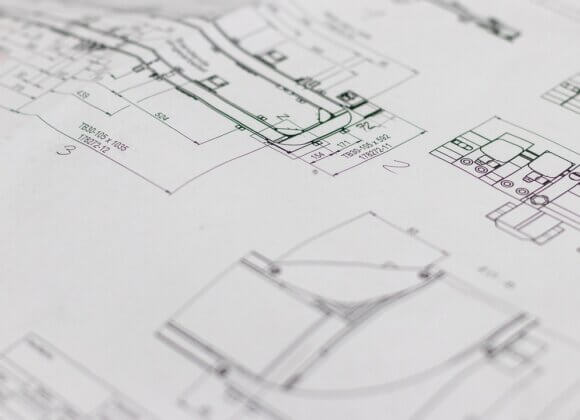Caves humides, fenêtres ou toits non étanches, ponts thermiques, moisissures, etc. – lorsque des défauts de construction apparaissent, les ennuis sont souvent programmés. L’expert en droit immobilier Lukas Gottardis de pgf Rechtsanwälte sait ce qu’il faut faire en cas de problème.
La joie de la nouvelle maison ou du nouvel appartement n’est pas toujours de longue durée. Si les premiers défauts apparaissent, elle est rapidement ternie, notamment en raison du risque d’un litige long et coûteux.
Qu’entend-on par défaut de construction ?
« Il n’existe pas de définition légale des défauts ou des dommages de construction », explique Lukas Gottardis, expert en droit du logement. En droit civil, on entend par défaut un écart entre l’état réel et l’état théorique dû. « Dans la pratique, on parle donc de défaut (de construction) lorsque certaines caractéristiques convenues par contrat ne sont pas présentes », explique Gottardis. Toutefois, les règlements de construction définissent certains défauts techniques – dans le règlement de construction de Basse-Autriche, il s’agit par exemple de moisissures ou d’humidité.
Qui doit prouver l’existence de défauts ?
Il convient ici de faire une distinction. Le maître d’ouvrage doit prouver l’existence d’un défaut, que ce défaut était causal pour le dommage survenu et qu’il existait au moment de la remise. Il existe toutefois une exception : si un défaut apparaît dans les six premiers mois à compter de la prise de possession de la maison ou de l’appartement, la loi présume qu’il existait déjà de manière cachée au moment de la remise – dans ce cas, la charge de la preuve est renversée.
Quels sont les délais à respecter en cas de défauts de construction ?
Il y a d’abord le délai de garantie. Elle est de trois ans pour les constructions considérées comme des biens immobiliers et les éléments fixes du bâtiment tels que les fenêtres, le chauffage, le carrelage ou les installations électriques. Pendant cette période, l’entreprise qui a réalisé les travaux doit garantir qu’il n’y a pas de défauts.
« Le délai de garantie commence à courir à partir de la réception de la maison ou de l’appartement, respectivement à partir de l’achèvement des travaux des plombiers, menuisiers et autres artisans », explique Gottardis. D’ailleurs, l’obligation de garantie, qui ne peut pas être exclue par contrat, existe même en l’absence de faute.
En revanche, le droit à des dommages et intérêts dépend de la faute de l’entreprise exécutante. En effet, si un dommage a été causé par exemple par un travail non professionnel, des erreurs de planification ou des matériaux défectueux, les maîtres d’ouvrage peuvent, le cas échéant, demander des dommages et intérêts au responsable – et ce même après l’expiration du délai de garantie.
« Si l’on découvre par exemple après cinq ans qu’une mauvaise colle à carrelage a été utilisée, on peut tout de même faire une demande d’indemnisation », explique Gottardis. On dispose également d’un délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage et de l’auteur du dommage. Toutefois, tant le droit à la garantie que le droit à des dommages et intérêts – dans la mesure où le partenaire contractuel n’est pas compréhensif – doivent être exercés en justice – ce qui entraîne un certain risque de procès et de frais.
Comment procéder en cas de défauts de construction ?
Les constructeurs de maisons et les propriétaires d’appartements doivent s’adresser à ceux avec qui le contrat a été conclu. Alors que le constructeur de maisons conclut souvent des contrats individuels avec des professionnels, l’acheteur d’une unité de propriété a pour interlocuteur le promoteur immobilier. Dans ce cas, il faut en outre généralement une décision de la majorité pour faire valoir les défauts. Dans les appartements en location, le bailleur est le bon interlocuteur. Les défauts devraient dans tous les cas être communiqués par écrit et – si possible – bien documentés.
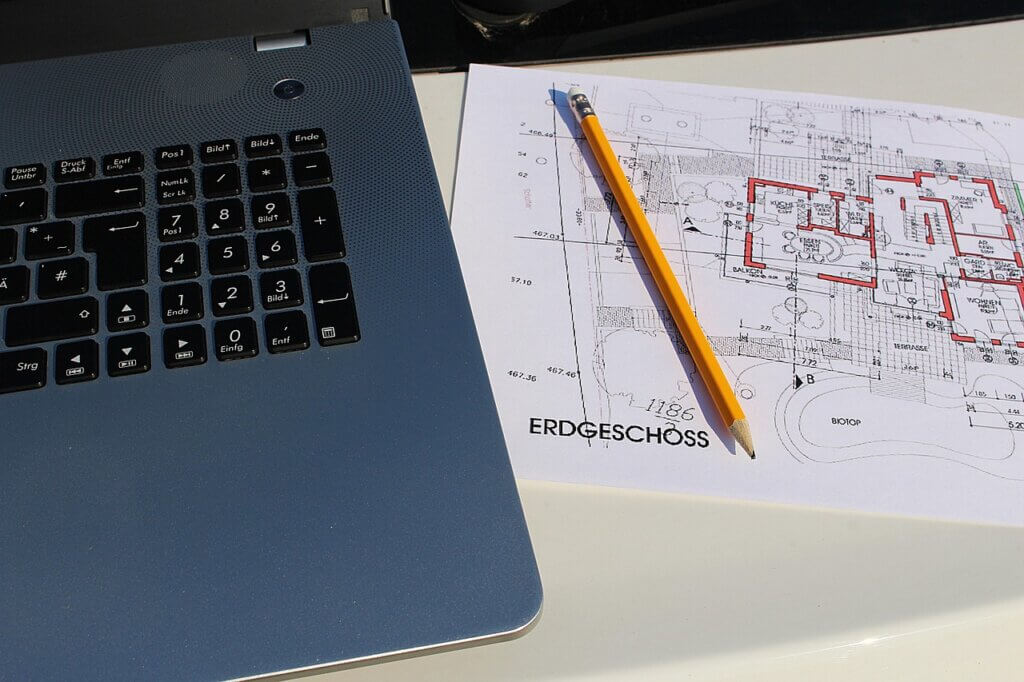
Qui doit réparer les défauts de construction ?
Les partenaires contractuels respectifs sont responsables de la réparation du ou des défauts. Ces derniers sont également responsables de la réparation du ou des défauts. Il convient de leur fixer un délai raisonnable à cet effet. En l’absence de réaction, il est possible, dans certaines circonstances, de procéder à une exécution de remplacement et de charger une autre entreprise de la réparation des défauts. Il est possible de se faire rembourser les frais par le partenaire contractuel qui a réalisé des travaux défectueux ou qui, comme le promoteur immobilier, en est responsable, le plus souvent par voie judiciaire.
Que faut-il savoir de plus en matière de paiements et de défauts de construction ?
Par exemple, que le droit de refuser de payer est l’un des instruments les plus importants pour protéger les clients en cas de défauts de construction. Ou qu’il existe également la possibilité de convenir contractuellement d’une retenue de responsabilité. Celle-ci représente généralement deux à cinq pour cent du volume de construction et est retenue jusqu’à la fin de la garantie. En cas d’acquisition selon la loi sur les contrats de promotion immobilière (BTVG), c’est-à-dire en cas d’achat d’un bien immobilier non encore achevé, cette garantie est obligatoire à hauteur de deux pour cent dans le cadre du modèle de garantie foncière avec plan de paiement échelonné le plus souvent utilisé.
D’ailleurs, les droits de garantie ne peuvent pas être exclus par contrat entre les entrepreneurs et leurs clients. Il en va autrement si l’on achète par exemple une maison à un particulier : ils peuvent très bien les exclure par contrat.
Peut-on se protéger contre les vices de construction ou les ennuis qu’ils causent ?
Pour éviter les défauts de construction, il convient de conclure, avant même le début des travaux, des accords aussi détaillés que possible sur les prestations respectives. En outre, avant de réceptionner chaque prestation partielle et le paiement partiel qui en découle, il convient de vérifier précisément si les travaux sont conformes aux accords et exempts de vices visibles.
« La plupart d’entre eux ne disposent toutefois pas des connaissances et des compétences nécessaires. C’est pourquoi il est tout à fait judicieux de confier la surveillance des travaux à un expert dans le cas d’une « construction privée » », conseille Gottardis. La tenue d’un journal de chantier et la documentation précise des travaux au moyen de photos ou de vidéos ont également fait leurs preuves. Cela permet de prouver, en cas de litige, d’où vient le défaut de construction et, le cas échéant, que celui-ci était déjà présent au moment de la livraison.
Il peut également être utile d’établir un protocole précis avec la ou les entreprises chargées des travaux lors de la réception définitive des travaux ou de la prise de possession de la maison ou de l’appartement. Tous les défauts visibles doivent y être mentionnés et il doit être convenu de la manière dont ils doivent être corrigés et dans quel délai.

Lukas Gottardis est associé et avocat chez pgf Rechtsanwälte à Innsbruck. En outre, ce juriste, qui a étudié à Innsbruck et a obtenu son doctorat en 2018, travaille comme lecteur à l’université d’Innsbruck et au WIFI Tyrol.
Contributions similaires :
Insolvabilité du promoteur immobilier – que faire ?